COMMENT ASSURER LA VIEILLESSE DES ARTISTES
Ce que disent les frères
Isola
01 /04/1909
 L'histoire de ces deux hommes pourrait
être racontée, ornée d'enluminures naïves, sur
une image d'Épinal. On y verrait se succéder une série
de dessins colorés représentant deux petits garçons
bien sages étudiant leur grammaire dans un petit café de
Blidah et se récréant,
leurs devoirs achevés, en regardant travailler les prestidigitateurs
qui fréquentaient l'estaminet paternel.
L'histoire de ces deux hommes pourrait
être racontée, ornée d'enluminures naïves, sur
une image d'Épinal. On y verrait se succéder une série
de dessins colorés représentant deux petits garçons
bien sages étudiant leur grammaire dans un petit café de
Blidah et se récréant,
leurs devoirs achevés, en regardant travailler les prestidigitateurs
qui fréquentaient l'estaminet paternel.
On les verrait ensuite âgés
l'un de douze ans, l'autre de dix, manier le rabot et faire leur apprentissage
d'ouvriers menuisiers.
Mais leur ambition était plus élevée et ils
rêvaient d'être des artistes. L'art, à cette
époque, était pour eux incarné par cette «
physique amusante » qu'ils avaient si souvent admirée et
dans laquelle, peu à peu, à force d'exemples, ils étaient
passés maîtres.
Si l'on croyait encore à ce mystérieux symbolisme qui anime
toute la littérature allemande, on pourrait dire que la double
pratique de la menuiserie et de la prestidigitation leur donna le goût
des planches. Toujours est-il que, poussés par une impérieuse
vocation, ils quittèrent bientôt le pays pour aller tenter
la fortune à Paris.
Comme les jongleurs du moyen
âge, ils se présentèrent non point de châteaux
en châteaux, mais de théâtres en théâtres,
partout éconduits, mais jamais découragés.
 On connaît les étapes de leur laborieuse et triomphante carrière.
Ils eurent de terribles débuts. Seuls, dans une ville où
ils ne connaissaient personne, ils parvinrent à se suffire, bien
mieux à toujours envoyer à leur père de quoi assurer
sa vie.
On connaît les étapes de leur laborieuse et triomphante carrière.
Ils eurent de terribles débuts. Seuls, dans une ville où
ils ne connaissaient personne, ils parvinrent à se suffire, bien
mieux à toujours envoyer à leur père de quoi assurer
sa vie.
Tout en cherchant des engagements, tout en faisant des soirées,
tout en donnant de représentations dans les petits cafés
de Paris et de la banlieue, ils n'abandonnèrent
pas leur métier de menuisier. Tout le jour ils maniaient le rabot
et la varlope, et, le soir, ils faisaient des tours.
Que d'anecdotes on pourrait raconter sur les
premières années de lutte de ces deux hommes qui sont maintenant
parmi les premiers directeurs de Paris qui ont possédé les
scènes les plus à la mode et qui ont, ceci est un chiffre
exact encaissé la somme fabuleuse de TRENTE
TROIS MILLIONS de recettes!.
Dans leur bureau directorial de la Gaîté,
ils égrènent, pour pouvoir se défendre d’un
peu 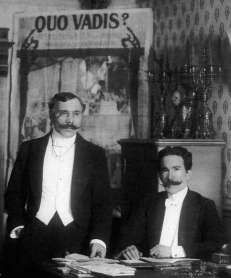 de
mélancolie, leurs souvenirs. Ils sont fiers de leur réussite,
mais ils sont plus fiers encore de ne la devoir qu'à eux mêmes.
de
mélancolie, leurs souvenirs. Ils sont fiers de leur réussite,
mais ils sont plus fiers encore de ne la devoir qu'à eux mêmes.
Nous sommes venus étudier avec eux les
moyens d'assurer la vieillesse des artistes et ce sujet les passionne.
- Ah! oui, s'écrient-ils, comme elle est souvent
douloureuse la situation des gens de théâtre, auteurs, acteurs,
voire directeurs.
Il y a dans cette classe qu’on dit
souvent privilégiée, un terrible prolétariat.
« Si vous saviez
toutes les misères qu'on doit supporter et quel courage et quelle
vertu il faut pour demeurer un honnête homme !
« La misère chez
les artistes, on la rencontre à tous les moments: à leurs
débuts,
Au lendemain de leurs plus grands succès, Surtout à la fin
de leur vie.
« Certains encore
sont aguerris. Ils en ont fait en quelque sorte l'apprentissage. Nous,
par exemple, si nous y étions exposés, nous saurions la
supporter, car nous l'avons tant connue, la misère, qu'elle a fini
par nous être familière et que nous la considérons
un peu comme une cruelle amie que nous avons quittée sans regrets,
mais que nous reverrions sans terreur.
« Mais pour
ceux qui n'y ont jamais été préparés, à
qui tout de suite la vie a souri, qui ont été gâtés
par une chance précoce, combien elle doit paraître redoutable
!
« Et c'est pour
cela qu'en vous consacrant à cette cause, vous accomplissez une
belle, une salutaire, une glorieuse mission.
« Pour assurer la vieillesse des artistes, il n'existe qu'un seul
moyen. Il faut, par une manière quelconque, les contraindre à
contracter une assurance et à payer une régulière
cotisation, qui leur permettront plus tard de finir paisiblement et heureusement
leurs jours.
« Depuis que nous gagnons de l'argent,
nous avons toujours agi ainsi. Et nous sommes' certains que si la réussite,
qui a bien voulu nous favoriser jusqu'ici se montrait pour nous capricieuse
et nous abandonnait, nous ne risquerions rien.
« Nous avons, chaque année, versé
à une compagnie d'assurances une somme suffisante pour nous rassurer
sur l'avenir.
« Il faudrait que
tous les gens de théâtre agissent ainsi. Il serait désirable,
il serait même nécessaire, qu'une sorte de Mutuelle existât,
qui, non seulement ferait aux vieux artistes une rente suffisante, mais
grâce à laquelle ils pourraient aussi être soignés
les jours de maladie, être aidés les jours de chômage.
« Celui qui entreprendra cette belle tâche
et qui s'y consacrera accomplira une sage besogne. Et croyez-moi, si l'on
voulait s'en donner la peine, on parviendrait vite à convertir
les cigales en fourmis.
« Mais nous vivons dans un temps où l'on
affecte l'imprévoyance. Nul ne songe au lendemain, et il semble
que les hommes de notre époque n'osent point considérer
l'avenir et que leur regard ne dépasse jamais ta minute présente.
« Oui, oui, poursuit énergiquement
M. Émile Isola, soutenu par l'affectueuse approbation
de son frère aîné, il serait excellent que Comœdia,
si dévoué aux artistes, s'attelât à cette campagne
et que votre journal fût le bienfaisant promoteur d'une vaste, d'une
générale « Mutuelle des Arts
»
Longtemps, longtemps, les Isola nous exposent leurs idées,
qui semblent confirmer celles que nos collaborateurs Emile Bergerat
et Henri Kistemaeckers ont exposées ici avec tant
de clairvoyance et d'autorité.
Maintenant, après s'être avec
nous entretenus de l'avenir, ils reviennent au passé. On sent qu'ils
tiennent plus à leurs années de peine qu'à leurs
années de triomphe. Et ils ont raison ! Ne sont-elles point pour
eux d'admirables actions d'éclat!
Entre tant de souvenirs charmants qu'ils nous content avec une poétique
sensibilité, il en est un que nous voulons reproduire :
- Nous avions vingt ans, nous disent-ils. Un
jour, nous nous trouvâmes sans argent, Sans pain, sans abri. La
nuit était venue. Longtemps, nous errâmes par les rues, enviant
les gens qui passaient et qui avaient dîné et qui savaient,
où dormir.
Et puis; épuisés
de fatigue, nous entrâmes dans le square des Arts-et-Métiers
et nous nous étendîmes sur un banc afin d'essayer de trouver
dans le sommeil un peu de repos et d'oubli. Jamais nous n'avions été
plus tristes, plus désespérés. Soudain, nos yeux
furent attirés par une affiche sur laquelle nous lûmes ces
deux mots : « La Gaité» La Gaité-!.
La Gaîté !. Ce soir-là, le nom du
théâtre devant lequel nous nous préparions à
passer la nuit nous parut alors d'une ironique cruauté.»
Nos yeux brouillés de larmes ne pouvaient se détacher
de cette « gaîté,» qui semblait à la fois
nous narguer et nous dire d'espérer » Qui nous aurait annoncé
qu'un jour nous serions les directeurs de ce théâtre dont
le nom nous avait tant frappés en cette nuit de famine et de lassitude!.
»
MANFRED.
